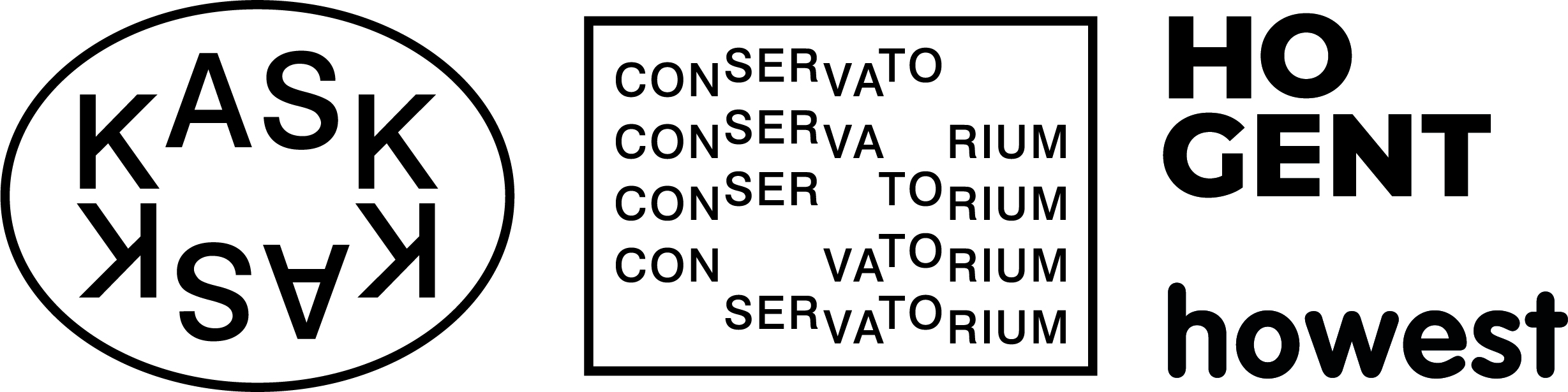Base de connaissances
Tous les thèmes (34) Contrats (7) Droit d'auteur (20) Droit des entreprises (1) Droit des marques (2) Droit fiscal (3) Droit social (2) Droits voisins (12) Éditeurs (3) Firmes de disques (1) Gestion collective (7) La musique dans l'audiovisuel (3) Législation (7) Live (2) Production (2)
-
Est-il judicieux pour un auteur/compositeur de créer sa propre maison d’édition musicale ?
Oui, surtout si vous travaillez régulièrement dans le domaine de l’audiovisuel et/ou de la radio pour produire des bandes sonores, des jingles, des soundbeds pour des publicités ou des jeux, etc. Votre client vous présentera alors généralement un contrat d’édition dont les conditions peuvent être assez lourdes. Vous pouvez vous armer contre cela en invoquant votre propre activité en tant qu’éditeur de musique . De cette manière, vous évitez de devoir céder 50% des droits d’auteur, puisque votre propre maison d’édition les possède déjà. Si nécessaire, il peut alors être décidé de conclure un accord de coédition avec l’éditeur du radiodiffuseur ou du producteur qui commande la musique, ou avec un éditeur de musique désigné par ce radiodiffuseur ou ce producteur. Ainsi vous pouvez garder, par exemple, la moitié de la part de l’éditeur pour vous.
Procéder à l’édition musicale n’est pas si difficile. Vous pouvez créer une entité juridique (une asbl, une srl, une sa, etc.) ou agir en votre nom propre, toujours en partirant du principe que vous serez redevable de la TVA. Logiquement, vous vous affilierez à la Sabam en tant qu’éditeur. Dans l’article 7 de son Règlement général, la société de gestion stipule un nombre de conditions formelles à cet effet : entre autres, la présentation d’un extrait des statuts ou de la Banque-Carrefour des Entreprises démontrant que l’activité d’éditeur de musique est inscrite dans le but de son entreprise, ainsi que l’indication du nom commercial sous lequel elle est exercée. Un contrat d’édition entre l’éditeur de musique et l’auteur devra également être établi, même si les deux personnes (physiques) coïncident. Il va sans dire que le traitement fiscal et comptable optimal sera également un sujet à considérer.
-
Qu’est-ce qu’un contrat de groupe ?
Un contrat de groupe régit la collaboration entre artistes qui créent et/ou exécutent conjointement des oeuvres musicales en tant qu’auteurs et/ou interprètes. Il est le résultat de leurs accords en matière d’enregistrements et de prestations live, mais également en matière de gestion financière et de certains aspects de propriété (matérielle et immatérielle) auxquels le groupe en tant que collectif doit inévitablement faire face, tels que les droits d’auteur, les droits voisins et les droits de marque sur leur nom et leur logo.
Les contrats de groupe sont traités en détail dans le chapitre 1 de la troisième partie de Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).
-
C’est quoi, le droit de synchronisation ?
Le droit de synchronisation en tant que tel ne figure pas dans la législation belge sur le droit d’auteur. La jurisprudence l’a développé pour les situations dans lesquelles une œuvre musicale ou l’enregistrement d’une exécution de celle-ci est lié à une œuvre audiovisuelle (ou dans lesquelles une œuvre musicale ou l’enregistrement d’une exécution de celle-ci est utilisé à une fin autre que celle à laquelle il était initialement destiné – par exemple, en relation avec une marque, ou dans la publicité). Cependant, on pourrait tout aussi bien soutenir que le droit de synchronisation est un dérivé du droit de reproduction. Et, bien sûr, il y a aussi un lien avec les droits moraux : un auteur ou un interprète peut vivre l’association de sa musique à des images comme une atteinte à l’intégrité de son œuvre ou de son enregistrement.
Vous trouverez plus d’informations sur le droit de synchronisation sous le titre « In sync », à partir de la page 478 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…). Ce titre s’inscrit dans le chapitre 2 de la quatrième partie de l’ouvrage, consacrée à l’utilisation de la musique dans les productions audiovisuelles.
-
‘Copyright’ ou ‘droit d’auteur’?
Lorsque « copyright » est le terme anglais standard utilisé pour désigner le droit d’auteur, dans une optique européenne il faut parler d’« authors’ rights ». Dans le monde anglo-saxon, la protection juridique est centrée sur la copie (« copy »), l’objet dans lequel le droit d’auteur est contenu. Ceci découle de l’accent mis dans les pays anglophones sur sa valeur économique négociable, tandis qu’en Europe continentale, l’auteur est lui-même le centre de la protection. Alors ne dites pas simplement « copyright » au lieu de « droit d’auteur » dans nos régions. D’autant plus puisque les Britanniques ont maintenant quitté l’Union européenne, et le terme tel qu’utilisé dans le système de common law n’est donc plus du tout pertinent pour les États membres actuels.
-
Une licence de la Sabam est-elle suffisante pour l’utilisation de musique existante dans une production audiovisuelle ?
Non. Outre les droits d’auteur sur les compositions synchronisées avec les images d’un film, d’une émission de télévision ou d’une publicité, il y a aussi les droits voisins portant sur les enregistrements des exécutions de ces compositions. Par conséquent, le consentement des propriétaires ou producteurs de ces enregistrements est également requis. En outre, la Sabam ne dispose pas d’un mandat englobant pour accorder des licences de synchronisation, de sorte que souvent l’autorisation doit être demandée directement à l’éditeur des compositions visées.
Le chapitre 2 dans la quatrième partie du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…) est entièrement consacré à l’utilisation de musique dans les productions audiovisuelles. La partie spécifiquement consacrée aux droits de synchronisation de musique existante va de la page 482 à la page 486.
-
Est-ce-que la mention du symbole © est requise pour la protection du droit d’auteur ?
Non, pas du tout. Ce symbole n’est en fait rien d’autre qu’un vestige d’une époque révolue, et il n’a de pertinence que pour les États-Unis. Vous trouverez une leçon d’histoire intéressante là-dessus sur le site web PlagiarismToday.
-
Quelles sont mes possibilités de gains en tant qu’auteur, musicien ou producteur ?
Ici vous trouverez un aperçu particulièrement intéressant de (des ?) 50 (!) façons de gagner de l’argent en tant que créateur musical. Notez bien que, en raison de la perspective américaine qui est prise comme point de départ, des nuances sont nécessaires – tenant compte surtout avec les pratiques aux États-Uni sur le plan de la gestion collective de droits, mis en lumière ailleurs dans cette banque de connaissances (voir Est-ce-qu’il me faut l’autorisation de l’auteur original pour sortir une reprise ou une traduction d’une oeuvre musicale ?). Ces pratiques sont radicalement différentes de celles que nous connaissons en Europe.
-
Que comporte exactement la directive européenne sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique ?
La directive européenne sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique du 17 avril 2019, vise, entre autres, à combler l’écart entre les revenus de plateformes comme Facebook et YouTube et le peu qui parvient aux créateurs du contenu par lequel ils sont générés. La directive entre dans l’histoire comme la directive la plus combattue et la plus médiatisée de tous les temps. Et principalement à cause du fameux article 13, qui est considéré par certains (les militants de l’Internet et YouTube en tête) comme un coup fatal porté à Internet et un exterminateur du droit à la liberté d’expression.
En renumérotant la version finale de la directive, l’article 13 est finalement devenu l’article 17. En vertu de cet article, les fournisseurs de services en ligne, afin d’utiliser un répertoire protégé par le droit d’auteur et par les droits voisins, auront à l’avenir besoin de l’autorisation des titulaires des droits exclusifs : les auteurs ou leurs éditeurs (ou leurs organismes de gestion collective) et les producteurs. Ils devront conclure avec eux des contrats de licence englobants, tout comme les utilisateurs du monde « physique ». Le répertoire pour lequel aucune autorisation n’a été accordée devra être retiré de leurs plateformes. Cependant, pour les nouveaux fournisseurs plus petits sur le marché des services en ligne, les règles concernant la suppression de contenu sont plus légères.
Les artistes-interprètes ne figurent pas dans la liste qui précède : qu’ils soient artistes principaux ou musiciens de session, ils cèdent toujours leur droit de communication au public et leur droit de mise à disposition du public à leur producteur. Celui-ci leur versera une rémunération pour cela, mais, comme nous le savons, celle-ci n’est pas fameuse. Les organismes de gestion collective des droits voisins des artistes interprètes et les groupements d’intérêt des artistes ont exercé conjointement de fortes pressions, dès le début du processus législatif qui a
conduit à la nouvelle directive, pour y remédier. Ils ont plaidé pour un droit à rémunération spécifique pour les artistes-interprètes : une rémunération équitable comparable à celle du monde réel, mais pour l’exploitation en ligne. Il dépendra de l’implémentation des dispositions de la directive dans le droit des États membres si oui ou non ce remède pour les faibles rémunérations pour le streaming que nous connaissons aujourd’hui, sera retenue.Outre celles de l’article 17, les règles applicables aux États membres dans les articles 18 à 23 de la directive sont également importantes. Leur objectif est de garantir aux auteurs et artistes-interprètes ou exécutants dans toute l’Europe a) qu’ils obtiennent une « rémunération appropriée et proportionnelle » pour l’exploitation de leurs œuvres et exécutions, b) qu’ils ont droit à la transparence en ce qui concerne cette rémunération, c) qu’ils peuvent exiger l’adaptation de leurs contrats si la rémunération initialement convenue est « exagérément faible » par rapport aux recettes totales d’exploitation de leurs œuvres ou exécutions, d) qu’ils ont recours à une procédure alternative volontaire de règlement des litiges concernant l’obligation de transparence susmentionnée et l’adaptation de leurs contrats, et e) qu’ils peuvent, au moyen d’un droit de révocation, reprendre leurs droits sur les œuvres ou exécutions qu’ils ont exclusivement octroyées sous licence ou cédées, si celles-ci ne sont pas exploitées.
Donc, à première vue, il y a de belles fondations. La question est toutefois de savoir dans quelle mesure les législateurs nationaux les mettront en œuvre avant l’échéance du 7 juin 2021. La directive laisse aux États membres une certaine marge de manœuvre pour exclure certaines catégories d’artistes ou pour réduire la portée de certains articles. Dans notre pays, le Conseil de la propriété intellectuelle (l’organe qui conseille le ministre fédéral de l’économie sur la législation dans le domaine de la propriété intellectuelle) a commencé immédiatement après son adoption à discuter de la transposition de la directive dans le droit belge. Toutefois, au moment de la mise à jour de ces lignes (le 27 juillet 2021), l’État belge n’était pas encore parvenu à la mise en œuvre finale. Ainsi, voir ce communiqué de presse sur l’appel de la Commission européenne à notre pays, mais aussi à 22 (!) autres États membres, pour procéder à la transposition.
Vous trouverez le texte français de la directive européenne sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique du 17 avril 2019 ici. Pour plus de contexte, nous renvoyons aux pages 530 à 535 au chapitre 5 de la quatrième partie du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).
-
Est-ce-qu’il me faut l’autorisation de l’auteur original pour sortir une reprise ou une traduction d’une oeuvre musicale ?
Les réponses à la question (distincte) s’il est possible de faire une reprise ou une traduction sans le consentement de(s) (l’)auteur(s) original/originaux, se trouvent ailleurs dans cette base de connaissances. La question qui se pose ici est de savoir si l’enregistrement d’une interprétation d’une telle reprise ou traduction peut effectivement être sortie. La réponse à cette question peut être différente, surtout s’il s’agit d’une diffusion (sur support matériel ou par voie numérique) aux États-Unis ou au Canada.
Dans ces territoires, les auteurs ou leurs éditeurs accordent eux-mêmes des licences mécaniques pour la diffusion d’enregistrements d’exécutions de compositions sur lesquelles ils peuvent faire valoir des droits – ceci en contraste avec la pratique dans nos régions, où l’obtention d’une licence mécanique se fait par l’intermédiaire d’organismes de gestion collective de droits d’auteur tels que la Sabam. En d’autres termes, aux États-Unis et au Canada les organisations locales d’auteurs telles que ASCAP et BMI ne s’occupent que des droits d’exécution, et non des droits de reproduction mécanique. Dans ces pays, l’auteur ou son éditeur perçoit ainsi directement la rémunération pour l’autorisation de la reproduction mécanique, du moins dans la mesure où il s’agit de l’exploitation locale des compositions concernées dans ces pays. Cette rémunération est basée sur un taux dit « statutaire » (« statutory rate »), c’est-à-dire un taux déterminé par le législateur américain. Dans nos régions, ce sont les tarifs négociés entre les organisations européennes d’auteurs et de producteurs de disques qui s’appliquent.
Vous trouverez plus d’explications sur ce sujet aux pages 310 et 311 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…), sous le titre « Anglais et Saxons ». Gardez en tout cas à l’esprit que, si vous diffusez aux États-Unis et au Canada, par le biais d’un agrégateur, des enregistrements de vos propres interprétations de chansons écrites par d’autres auteurs, vous devrez peut-être encore conclure un accord avec les auteurs ou les éditeurs concernés et verser une partie des redevances que vous recevez de votre agrégateur aux détenteurs des droits d’auteur.
-
Quelle est la différence entre un organisme de gestion collective et une société de gestion ?
Le terme « organisme de gestion collective » (OGC) est le terme générique utilisé dans la réglementation européenne pour désigner une société qui gère de façon collective des droits d’auteur ou des droits voisins. Ou, en anglais : « collective management organisation » (CMO).
Dans la loi belge, on parle depuis des années de « sociétés de gestion ». Un organisme de gestion collective fondé en Belgique doit notamment disposer d’une personnalité juridique et être à responsabilité limitée. Dans d’autres pays, cela n’est pas une obligation contraignante. Aux Pays-Bas, par exemple, une fondation peut aussi se charger de la gestion collective de droits. Les organismes
de gestion collective qui ne sont pas de droit belge peuvent aussi être actifs dans notre pays, en s’y établissant ou y installant une succursale. Ainsi, les deux notions figurent dans notre législation. Elle règle aussi bien les organisme de gestion collective que les sociétés de gestion, mais pas dans la même mesure. Qu’il soit clair en tout cas que toutes les sociétés de gestion sont des organismes de gestion collective, mais pas tous les organismes de gestion collective sont des sociétés de gestion.Pour plus d’informations à ce sujet, voir pages 160 et 161 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).
-
Est-ce-que je dois signer un contrat avec un éditeur pour protéger mes compositions ?
Juste comme il n’est pas du tout requis pour un auteur de s’affilier à une société de gestion ou à un organisme de gestion collective, ni de déclarer ses œuvres auprès d’une telle organisation, l’auteur n’est absolument pas obligé de conclure un contrat avec un éditeur. Ni l’un ni l’autre ne sont une condition pour l’établissement du droit d’auteur et la protection qu’il offre. Le droit d’auteur sur une œuvre, en effet, naît par sa simple création. Éventuellement, un éditeur pourra se charger de l’exploitation des œuvres d’un auteur, tandis que la société de gestion ou l’organisme de gestion collective auquel(le) l’auteur et l’éditeur sont affiliés négociera la rémunération due par les utilisateurs de ces œuvres ; la société de gestion ou l’organisme de gestion collective percevra ensuite cette rémunération et la versera à l’auteur et à l’éditeur, après déduction de ses frais de fonctionnement.
-
Est-ce-que je dois déclarer mes compositions auprès d’une société d’auteurs pour les protéger ?
Le droit d’auteur sur une œuvre découle automatiquement de sa création. En d’autres termes, son existence ne dépend pas de l’accomplissement de formalités de quelque nature que ce soit. Il ne nécessite pas l’affiliation à une société de gestion telle que la Sabam, ni une déclaration des œuvres de l’auteur à cette société de gestion; contrairement à ce qui est courant aux États-Unis, où l’auteur doit, par exemple, enregistrer son œuvre auprès d’une institution gouvernementale ou y inclure certaines mentions formelles avant de pouvoir invoquer son droit d’auteur dans une procédure judiciaire.